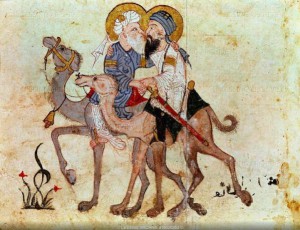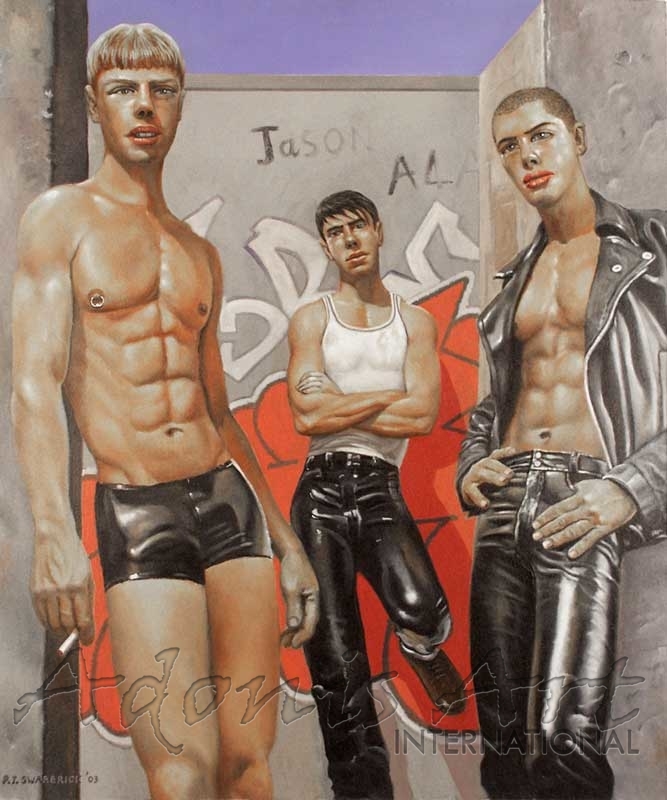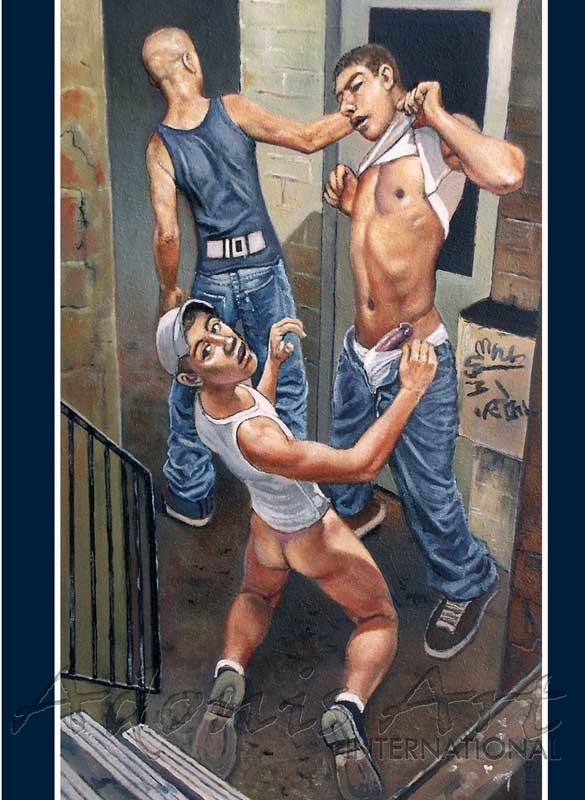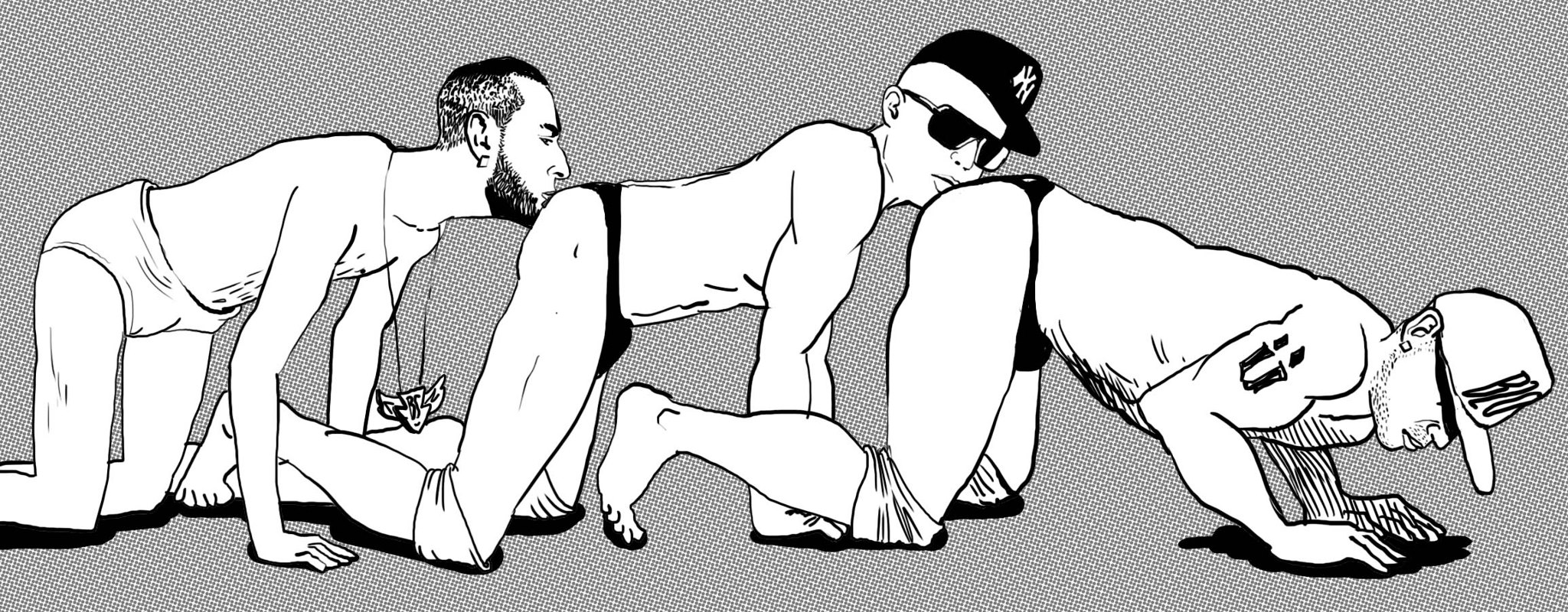Un article de Elena Avija, paru en 2012, pour comprendre comment une certaine grille de lecture de l’homosexualité et de l’homophobie s’est instaurée ces dernières années et nourrie l’homonationalisme en opposant « la République » aux « cités » et à la « culture maghrébine ».
Un article de Elena Avija, paru en 2012, pour comprendre comment une certaine grille de lecture de l’homosexualité et de l’homophobie s’est instaurée ces dernières années et nourrie l’homonationalisme en opposant « la République » aux « cités » et à la « culture maghrébine ».
Les lignes qui suivent se proposent de prendre pour point de départ le processus d’écriture, de publication et de promotion des deux livres Homo-ghetto. Gays et lesbiennes dans les cités : les clandestins de la République, de Franck Chaumont et Un homo dans la cité. La descente aux enfers puis la libération d’un homosexuel de culture maghrébine, de Brahim Naït-Balk. L’important relais médiatique qui a suivi leur publication est en effet parlant. Avec plus de vingt occurrences en quatre mois sur les chaînes de télévision et la presse papier nationale, l’engouement médiatique pour les deux livres est immédiat.
Le choix des titres et des mots-clefs donne immédiatement à voir les associations et les antagonismes sur lesquels se basent les livres. La « République » est opposée aux « cités » et à la « culture maghrébine », deux supposés « enfers » pour les personnes homosexuelles.
Ancien responsable de la communication pour l’association Ni Putes Ni Soumises, et actuellement attaché parlementaire de la députée socialiste Aurélie Filipetti, l’auteur de Homo-ghetto mobilise dans son livre et à l’occasion de ses apparitions médiatiques, les statistiques produites par l’association française SOS homophobie. Ces dernières lui permettent de bâtir un argument selon lequel l’on assisterait actuellement à « l’instauration d’une communauté homosexuelle à deux vitesses. » D’un côté il y aurait « cette homosexualité établie, maintenant reconnue, dans les centres villes, qui est prescriptrice de tendance, qu’il est de bon ton de fréquenter, qui obtient de plus en plus de droits, et à côté de là, mais à 10km du centre ville, dans des cités ghetto qui sont exclues de toute modernité, on a affaire à une homophobie qu’on aurait même pas imaginé, qu’il n’y aurait même pas eu 50 ans avant » (Chaumont, invité sur le plateau de « Vie privée vie publique », France 3, le 02.10.09) [2]. Ces statistiques sont ensuite relayées dans la presse [3]. SOS homophobie, qui produit ces chiffres, dispose du monopole de la production des statistiques liées à l’homophobie. Elle est le seul organisme en France à diffuser annuellement des publications quantitatives sur la question. Or, l’on sait que « la production de chiffres, loin de ne faire que refléter la réalité, contribue à la définir, et, de ce fait, contribue à durcir le ‘‘problème social’’ » (Tissot, 2004, 91). Ces statistiques, ainsi visibilisées dans l’espace médiatique, ont à leur tour contribué à dessiner les contours du phénomène décrit dans le livre de Franck Chaumont : « l’homophobie en banlieue ».
Cet article se propose ainsi de revenir sur la genèse de ces statistiques à travers le livre de Franck Chaumont et de sa promotion médiatique. Pour comprendre la fabrication des représentations autour des sexualités, il est nécessaire de se pencher sur les processus de production des chiffres qui les consolident. Retracer ce parcours, du chiffre statistique au chiffre politique, permettra de saisir les nuances et les décalages qui sont à la base des discours médiatiques mais qui n’apparaissent cependant pas une fois l’article journalistique publié. Pour commencer, je reviendrai sur les axes qui structurent le livre de Franck Chaumont.
Homo-ghetto : la dichotomie centre-ville/banlieue
Le livre de Franck Chaumont est structuré en une succession d’une dizaine de témoignages. Une introduction ouvre le sujet, résumant brièvement le parcours de l’auteur et les éléments qui l’ont amené à l’objet de son livre. La deuxième partie comporte une généalogie de dates clefs de l’histoire sociale de l’homosexualité, un « tour du monde » de l’état des droits des personnes LGBT, ainsi qu’un bref retour sur les témoignages sous forme d’« analyse ». La plupart des témoins interrogé-es sont des hommes (dix sur quatorze), la majorité d’entre elles/eux sont décrit-es comme étant « d’origine maghrébine ». Les deux témoins franco-français-es, sont pour l’un éducateur et pour l’autre, enseignante (et seule hétérosexuelle interrogée). Les deux résident en « banlieue » dans le cadre de leurs fonctions professionnelles.
La démarche de Franck Chaumont se base sur une mise en opposition de deux formes de vécu de l’homophobie : celle rencontrée selon lui dans les quartiers dits sensibles, et l’autre, supposée moins violente, des centre-ville. Cette mise en opposition implique tacitement une comparaison. Pour affirmer qu’une situation est pire qu’une autre, il s’agit de pouvoir décrire les deux. Franck Chaumont s’applique à restituer, selon ses propres grilles d’analyse, des témoignages venant de l’un de ces espaces, les « banlieues » sans pour autant proposer d’investigation sur les questions d’homophobie et d’homosexualité en général.
* « Du coup, pour écrire votre livre, est-ce que vous avez au préalable aussi fait une recherche sur des livres qui traitent d’homosexualité, ou de banlieue… comment ça se passe quand on écrit un livre ?
* Oui, on regarde. J’ai fait une recherche sur ce qui était sorti en presse écrite magazine, j’avais déjà lu par ailleurs, j’ai cherché des livres… J’ai fait google homo, cité homo. Après j’ai lu des bouquins sur le monde arabe. C’est l’éditrice qui m’a conseillé des bouquins, elle me disait « tiens lis ce bouquin il sort dans 15 jours » donc voilà je l’ai lu. Après, j’ai lu des choses sur la ghettoïsation plutôt, parce que moi mon sujet était aussi de montrer comment se met en place une ghettoïsation, un enfermement. C’est la ghettoïsation qui créé ce recul en banlieue… Donc sur l’homosexualité en banlieue, aucun livre n’était sorti. Après, y avait des livres qui étaient sortis, c’était les homos et l’islam, mais c’est différent. C’est pas dans les quartiers. Voilà, donc c’était rapide parce que y a pas tellement de choses. » (Entretien avec Franck Chaumont)
Dès lors, une série d’évènements qui peuvent lui paraître spécifiques aux « banlieues » peuvent très bien se révéler être en réalité propre aux situations quotidiennes d’homophobie. Les situations que décrit Franck Chaumont seront pour la plupart familières à la lectrice et au lecteur connaissant ne serait-ce que superficiellement la littérature ou le quotidien gai et lesbien. L’homophobie dans les « banlieues » selon Franck Chaumont, se passe un peu comme dans les romans de Proust : « Charlus n’aime pas Vaugoubert : il le trouve trop voyant, trop exubérant. Il se veut viril et déteste l’efféminement. Il se veut discret et craint les effets de cette exubérance. » (Proust, 1921) Ainsi,
« Majid préfère les garçons aux filles, mais déteste les pédés. C’est ainsi qu’il m’avoue ingénument avoir organisé une expédition punitive pour jeter des cannettes de bière sur des homos, à l’île du Ramier, l’un des principaux lieux de drague de Toulouse. En vrai petit gars des cités, il rejette avec violence la représentation sociale de l’homosexualité. Dans sa hiérarchie des valeurs, l’homo passif, inexcusable, est voué aux gémonies. » (Chaumont, 2009, 20)
Les phénomènes décrits obéissent aux structures d’un « placard » homosexuel qui implique une intériorisation de l’homophobie et de la hiérarchie des sexualités. Il s’agit non seulement de taire sa sexualité, mais également d’éviter d’en porter les apparents stigmates. Dès lors :
« il ne paraît pas non plus improbable [que] (…) contre des stéréotypes négatifs, contre un regard blessant ou de simples insultes, contre une interprétation coercitive de nos productions corporelles, certain(e) puissent choisir de rester délibérément au placard ou d’y retourner dans certains ou tous les segments de leur vie. » (Kosofsky-Sedgwick, 1990, 86).
Une grille de lecture culturaliste
Toute l’analyse de Franck Chaumont s’appuie sur des grilles de lectures préexistantes à son étude. D’une part, la dichotomie, essentielle, sur laquelle se base le livre en question, celle qui sépare « les centres villes » des « banlieues », ne fait à aucun moment l’objet d’une définition. Parle-t-il de toute la périphérie parisienne ou uniquement des quartiers les plus défavorisés ? Les explications de l’auteur recourent essentiellement à des lecures en terme de « culture » ou de « religion ». Quand ces deux éléments ne peuvent expliquer un phénomène (l’homophobie ou son absence), ils deviennent dès lors des caractéristiques à expliquer :
« Entendre une mère maghrébine parler d’un sujet aussi peu évident avec un tel naturel m’épate (…) La réaction de Jamaïa m’étonne de plus en plus. Comment une femme de son âge qui, comme elle, baigne dans la culture maghrébine, peut-elle faire preuve d’une telle ouverture d’esprit ? Là encore, la réponse fuse : ’’C’est Dieu qui l’a fait comme ça !’’ Comme Jamaïa n’envisage pas de critiquer l’œuvre de Dieu, elle ne peut qu’accepter son fils tel qu’il est. » (Chaumont, 2009, 95-97)
Cette citation nous permet de dégager deux éléments. Incapable de penser en dehors des schèmes religieux qui structurent sa vie de « mère musulmane », l’enquêtée ne pourrait donc accepter l’homosexualité de son fils qu’avec l’accord divin. La marge de manœuvre et de réflexion qu’une « mère occidentale » (ou blanche) pourrait avoir dans une laïcité très républicaine est perçue dans le cas d’une « mère maghrébine » avec un très grand étonnement, et est expliquée par un recours à l’œuvre d’un Dieu qu’elle n’envisagerait pas de critiquer.
Ce commentaire s’appuie sur des schémas de pensée essentialistes et culturalistes qui attribuent à certaines catégories d’individu-es des comportements figés dans ce qui est défini comme une certaine « culture », et reproduit des dichotomies entre des manières de penser qui seraient tributaires d’une capacité à raisonner de manière autonome et d’autres qui ne pourraient se faire que dans le cadre de la foi et de ses structures. Comme l’explique Annamaria Rivera,
« dans cette perspective, la ‘‘« culture judéo-chrétienne » est considérée comme supérieure car elle est libérale, flexible et en perpétuelle évolution tandis que la culture musulmane, essentiellement perçue comme un carcan strict et figé, restreindrait la liberté de l’individu et expliquerait ses problèmes’’ d’intégration dans les sociétés européennes » (Rivera, 2000, 81).
Ainsi, la culture, comme critère causal, n’intervient que pour expliquer l’homophobie des groupes racisés. Les femmes et hommes blanc-hes, quant à elles/eux, n’ont nul besoin d’être caractérisé-es en termes culturels, puisqu’elles/ils font partie intégrante de la culture de référence qui n’a guère besoin de se parler. Lorsque
« les agents impliqués sont des immigrant-es de couleur, un comportement que nous considérons comme problématique, nous le qualifions de ‘‘culturel’’(…). En revanche, si dans des circonstances analogues, il s’agit [de blancs], nous y voyons un cas isolé de comportement aberrant et non l’expression d’une culture racialisée » (Volpp, 2006, 15).
Notes de la première partie
[1] Cet article est tiré d’un travail de recherche intitulé « La construction de l’homophobie comme problème des banlieues françaises »
[2] Les chiffres cités dans la presse seront toujours les mêmes. Par exemple : « Cet ancien journaliste à Beur FM et RFI cite une enquête de SOS Homophobie datant de 2006 et assurant que 46 % des violences faites aux homosexuels ont eu lieu dans les quartiers populaires bordant les grandes villes. » (Anna Topaloff, « Les homos damnés des cités » in Marianne, 25.09.2009)
[3] Pour ne citer que les plus grands médias nationaux, les chiffres de l’association ont été mobilisés dans la presse écrite : Inrockuptibles, Le Nouvel Observateur, Marianne, la presse radio : France Culture, et la presse télévisuelle : France 3, France 5, M6 (liste non exhaustie).
Deuxième partie
En 2005 et en 2006, le rapport Annuel de SOS homophobie contenait un chapitre « Banlieues ». Ce chapitre se proposait de faire le point sur la spécificité de l’homophobie dans les « banlieues » françaises. Un groupe de travail « Banlieue » s’est réuni de 2004 à 2008, chargé de la rédaction du chapitre correspondant au sein du rapport annuel. Les données sur lesquelles se basaient les rédactrices/eurs étaient d’une part les témoignages (appels, e-mails, courriers) reçus par l’association, et d’autre part une enquête par questionnaire (diffusé par Internet) sur « l’homophobie en banlieue » dont les résultats finaux n’ont jamais été publiés. Le matériel mobilisé par Franck Chaumont dans les médias, se référait ainsi aux statistiques produites par SOS homophobie dans son rapport annuel de 2006.
Le rapport annuel étant principalement adressé à des journalistes ainsi qu’à des politiques, son contenu ainsi que sa forme se doivent d’être aisément abordables. Il s’agit donc de traduire les données récoltées dans un langage qui puisse être mobilisé par des journalistes, des administrations, des femmes et des hommes politiques.
« Les journalistes ! Les journalistes aiment ça, ça leur permet d’aller vite, ça leur permet de mettre un petit graphique à côté de leur petit texte. Nous demandent ça également les hommes politiques… ‘‘Chez moi, y a des appels de chez moi ?’’, ‘‘Alors la Corse du Sud vous voyez, vous êtes en noir y a plein d’appels chez vous !’’. Ca les intéresse à ce niveau- là, ils voudraient ne pas apparaître en noir… » (Entretien avec Paul, SOS homophobie)
Ce passage de la donnée brute à la citation « prête à l’usage » est ainsi révélateur de plusieurs enjeux. Il s’agit d’une part de permettre aux interlocutrices/eurs extérieur-es une utilisation des données simple, rapide et efficace. Pour cela, il est impératif que la présentation graphique des données soit soignée (ici sous la forme de « camemberts »).
Les statistiques de SOS homophobie sont produites à partir des témoignages reçus, par courrier postal (une petite minorité), par e-mail, et pour la grande partie par appels téléphoniques sur la ligne d’écoute anonyme. La première étape consiste à entrer des paramètres dits objectifs dans une base de donnée établie à cet effet. Ces paramètres sont l’âge, le sexe, le lieu d’appel etc. L’anonymat des appels étant garanti, il n’existe concrètement aucun moyen d’assurer la véracité des informations que les appelant-es donnent aux écoutant-es. Le caractère relativement flou des précisions récoltées, notamment géographiques, rend l’indexation, première étape de la fabrication des statistiques, relativement compliquée et imprécise.
* « Et les appels sont répartis géographiquement aussi… c’est à quelle échelle ? Commune, département ?
* Non, non… on a pas ce degré de précision. Parce que nous par exemple, les témoignages qu’on reçoit par courriels, ceux-là pour le coup c’est vraiment spontanément, donc quand les gens ne cochent pas (…) et ils le font ou ils le font pas, on a pas les moyens… alors qu’à l’écoute on peut être un peu plus à la recherche de ces informations, donc demander à la fin « mais vous appelez d’où ? »… Donc y en a qui nous disent vraiment je suis dans le… mais y en a qui veulent pas nous dire ! Ils ont peur… donc on a beau leur dire « mais on fait un usage anonymisé » (Entretien avec Paul)
Une première distinction existe entre le lieu réel d’appel, et le lieu d’appel déclaré. Cette précision ne figure pas dans les rapports de l’association ou dans les légendes de ses tableaux. Or, c’est précisément sur la récolte de ces données-là que sera ensuite calculée la proportion d’appels en provenance « de banlieue ». Pour ce faire, tous les appels déclarant être passés de la couronne parisienne seront pris en compte. Par ailleurs, lorsque SOS homophobie parle de « banlieue, ce n’est pas dans son acception géographique mais bien dans ce que le mot peut évoquer en terme de zone cumulant des difficultés sociales, économiques, et regroupant des personnes souffrant d’exclusion et de pauvreté » [1].
Or, les données chiffrées utilisées pour établir les statistiques de cette « banlieue sociale » sont les mêmes données venant des « banlieues géographiques », qu’elles soient défavorisées ou riches. Ainsi, la définition de ce que signifie réellement « banlieue » varie selon que l’on parle du chiffre statistique brut (calculé en fonction des appels en provenance des banlieues dans le sens géographique du terme) ou du chiffre politique, qui lui fera référence uniquement aux « banlieues défavorisées ».
Ces deux premiers glissements témoignent de la difficulté réelle de produire des chiffres qui tiennent, [2] sur la question de l’homophobie en banlieue. De plus, une fois les données d’un appel indexées se pose la question des « doublons ». Une personne peut par exemple appeler plusieurs fois et modifier quelques données pour ne pas être reconnue. Ses coordonnées entreront ainsi à plusieurs reprises dans la base de données et contribueront à renflouer les statistiques liées à son lieu supposé d’appel (s’il ne change pas), ou à une certaine spécificité de son histoire (problème familiaux, travail, etc). Un système de recoupement des données est censé neutraliser ce biais, mais la peur d’être identifié-e rend l’élimination des doublons relativement difficile.
Une fois l’année écoulée, les « co-référents » (les responsables) du rapport annuel impriment les fiches remplies et les distribuent par thèmes aux rédactrices/eurs. Chacun-e d’entre elles/eux a la charge d’effectuer ses propres statistiques. Elle/il dénombre ses fiches, compte le nombre de femmes, d’hommes, d’habitant-es de Paris, de province, etc… Ces calculs se font en autogestion, aucune formation statistique n’étant prévue par l’association :
« (…) et ça c’est le plus dur, hein, honnêtement… c’est pas l’analyse des fiches, ça c’est plaisant, mais là la partie statistique… c’est la partie la plus périlleuse ! Moi, normalement c’est des choses… pas de soucis ! 1 plus 1 grosso modo normalement ça fait 2 ! Et j’ai compté ! Et j’ai compté ! Et j’ai re re compté les fiches ! C’est un travail incroyable ! Je me disais mais c’est pas possible ! Il s’agit juste de faire un décompte, c’est mathématique, c’est pas possible… Franchement, je retombais jamais sur mes pieds (…) Y a pas plus objectif que ça quand même ! Alors je faisais mes petits tas. (…) fiche homme, fiche homme, fiche femme, hunhun 26, après, province, étranger, province, paris, étranger, ah tiens est-ce que c’est la même chose que celle-là ? Bon voilà ! Et tout ça c’était assez long, franchement, je n’en revenais pas qu’un travail à priori aussi mécanique puisse être aussi fastidieux et surtout aussi compliqué ! La partie statistique effectivement, c’est pire que tout ! Et quand on le fait, on voit aussi les limites de l’exercice… » (Entretien avec Paul, SOS Homophobie)
Le manque de sentiment de compétence de Paul est éclairant. En effet, l’incertitude liée au caractère anonyme des témoignages est bien renforcée par la pratique profane des statistiques. Le manque de formation aux outils statistiques associé aux difficultés techniques développées ci-dessus et au nombre relativement peu important d’appels reçus rend le processus de fabrication des statistiques sur « l’homophobie en banlieue » d’autant plus bancal.
*« Et en Ile de France, les départements desquels les gens appellent le plus ? Y a une concentration dans certaines départements ou c’est…
* Nan… c’est difficile à dire ça… on rentre pas dans ces détails… Là, justement, on touche un peu aux limites de la chose… On a 1300 témoignages par année. C’est à la fois beaucoup et pas beaucoup… C’est peu, dans le sens où… est-ce que c’est significatif d’avoir reçu 30 appels de Paris, 15 appels de Ivry, 20 appels de Clichy, 18 appels de Seine St Denis… quand c’est ces proportions-là, ça va. Mais c’est pas ces proportions-là… globalement oui, par départements c’est dans ces eaux là, on peut se dire ouh, y a eu beaucoup d’appels des Bouches-du-Rhônes… mais est-ce que ça a du sens ? » (Entretien avec Paul, SOS homophobie)
La collaboration entre Franck Chaumont et SOS Homophobie : échange de bons procédés et promotion mutuelle
SOS homophobie est citée lors d’une grande partie des interviews données par Franck Chaumont ou des sujets consacrés au livre. La plupart de ces références mobilisent un chiffre en particulier : 46%. Ce qui se réfère à ce chiffre, cependant, est tout à fait différent dans les analyses du rapport annuel de l’association et dans les articles et les émissions citant ce même rapport.
* Les Inrockuptibles, 29.09.2009, Hugo Lindenberg. « Pas de quartiers pour les homos. A deux pas des centres-villes, les jeunes gays et lesbiennes des cités vivent un enfer social. »
« (…) Réjouissons-nous alors que l’association SOS homophobie, qui relevait en 2005 que 46% des témoignages d’agressions physiques qu’elle recevait émanaient de banlieue, vienne d’être agréée par le ministère de l’Education nationale pour intervenir en milieu scolaire ».
* « C’est à vous », France 5, 29.09.09
Question spectatrice/eur : « Y-a-t-il plus d’homophobie dans les banlieues que dans les campagnes ? »
Franck Chaumont : Je sais pas s’il y en a plus. En tout cas ce que je sais, c’est qu’elle est beaucoup plus installée, comme si elle était institutionnalisée et qu’elle a un degré de violence supérieur. SOS homophobie a fait une enquête sur 4000 témoignages, 46% proviennent des cités et sur ces 46%, 50% proviennent de jeunes. »
Informés par Franck Chaumont, la plupart des articles de presse laissent entendre que près de la moitié des témoignages relatant un cas d’agression physique ont lieu en « banlieue ». Si cette information ne fait qu’appuyer les propos qui composent le livre de ce premier, elle n’en est pas moins en inadéquation avec les chiffres publiés par SOS homophobie. Ainsi, ce ne sont pas seulement les biais restitués ci-dessus qui alimentent les représentations de la « banlieue homophobe », mais bel et bien une lecture infidèle des schémas et des analyses de l’association :
Graphique 1 : « Analyse » des témoignages déclarant venir des périphéries des grands centres urbains en France (essentiellement de Paris)

Les 46% cités apparaissent effectivement dans l’analyse consacrée aux « banlieues » de SOS homophobie. Cependant, l’analyse descriptive indique que ces 46% désignent la proportion des agressions physiques parmi toutes les formes d’agressions recensées « en banlieue » :
« Manifestations / profil des agresseurs : la majorité des appels cumulent insultes (78%), harcèlement (49%), menaces (43%) et agression physique (46%) du fait de jeunes agissant en bande (54%). Ici aussi, ces manifestations homophobes caractérisent la spécificité des agressions en banlieue et confirment les chiffres du rapport 2005. » (Rapport annuel SOS homophobie 2006 p. 72)
Le glissement sémantique est le suivant. Les chiffres de SOS homophobie indiquent que parmi les témoignages émanant « de banlieue » (des riches comme des pauvres), 46 % d’entre eux faisaient mention d’une agression physique. La réception et le relais de l’information dans les médias indiquent que 46% des témoins évoquant des agressions physiques appelaient des banlieues. Or, le graphique 2 ci-dessous, en page 56 du même rapport annuel dont s’inspire Franck Chaumont (rapport annuel 2006) montre que 24% des appels témoignant d’agressions physiques émanent d’Ile-de-France.
Graphique 2 : « Analyse » des témoignages relatant des cas d’agression physique sur la totalité des appels reçus par SOS homophobie

Comme l’indique le sous-titre du graphique 1, le pourcentage de témoignages en provenance « des banlieues » se monte quant à lui à 3% (37 témoignages). Dès lors, il devient impossible que 46% des témoignages mentionnant une agression physique de l’ensemble des appels proviennent des 3% qui constituent la proportion des appels venant des périphéries des grands centres urbains. Les représentations de l’association sur les quartiers dits sensibles s’appuient sur une vision des statistiques basée sur l’idée d’exemplarité. Les 3% qui constituent les appels en provenance de « banlieue » sont tirées non seulement des statistiques, mais également des « analyses qualitatives » se basant sur les témoignages reçus. L’association est ainsi tributaire d’une vision selon laquelle « les quelques cas décrits (peu nombreux) [sont] supposés typiques. La société [est] pensée comme un tout, dans une perspective holiste : la connaissance d’un cas fournit celle du tout. L’exemple typique est supposé représentatif du tout si l’on a un contact personnel avec ce cas. » (Desrosières, 1989, 237).
L’usage social des productions statistiques s’inscrit dans une histoire et un héritage long de ces instruments de mesure. Ces techniques évoluent et s’adaptent, mais sont intimement ancrées dans une certaine culture de la représentativité et de l’exemplarité. L’usage statistique des chiffres liés aux quartiers dits sensibles s’inscrit dans cette tendance. La preuve en réside dans le fait qu’il n’est jamais spécifié de quelle « cité » l’on parle, que ce soit dans les articles de presse, dans les rapports de SOS homophobie, ou dans les livres de Franck Chaumont. La question de l’anonymat et de la protection des sources n’entre pas seule en compte. Intervient également l’impression que les témoignages, tout comme leurs lieux de provenance, sont interchangeables et se valent à tous les points.
C’est grâce à une inversion plus ou moins subtile des termes composant une affirmation statistique que le 46% des appels de « banlieue » (3%) devient un 46% parmi tous les appels. Les productions de SOS homophobie ne sont pas fidèlement relayées par Franck Chaumont, ni par les journalistes qui l’interviewent. Cette information erronée ayant largement circulé par les réseaux télévisuels, radiophoniques, par la presse papier nationale comme régionale et enfin par Internet et les multiples blogs dont il regorge, la promotion du livre de Franck Chaumont a contribué à cristalliser et à quantifier la question de « l’homophobie en banlieue » en se basant sur des statistiques erronées. L’on connaît l’importance de « l’apparence de l’évidence et de la pleine vérité [ ] dans [la] sélection [des problèmes publics] ; ‘‘des faits froids et durs’’ et l’impression donnée d’une expertise technique sont de puissantes ressources pour construire des représentations dominantes » (Hilgartner et Bosk, 1988, 61).
Or, SOS homophobie ne semble pas s’offusquer de l’utilisation déviée de ses rapports annuels et de ses enquêtes. Aucun démenti ne sera publié à aucun endroit. Au contraire, la contribution de Franck Chaumont à la visibilité de l’association sera plusieurs fois saluée :
« Enfin notre association a été citée à deux reprises. Le 24 septembre90, Franck Chaumont était interrogé, lors de la sortie de son livre Homo-ghetto. Gays et lesbiennes dans les cités, sur la vie des homosexuel-le-s en banlieue. “ La communauté homosexuelle marche à deux vitesses, méfiance, insulte, violence, jusqu’aux passages à tabac et aux viols, les homosexuel-le-s vivent un véritable calvaire. ” Pour eux c’est la double peine car “ la communauté homosexuelle reproduit une discrimination à leur égard, ils sont fustigés dans leur cité et réduits à leur beuritude ou blackitude en centre-ville ” » (rapport annuel 2010, SOS homophobie, p. 110)
Si l’association ne cite pas directement les passages faisant références à ses statistiques, elle ne les dément pas non plus. L’extrait choisi par SOS homophobie dans son rapport se poursuit quelques lignes plus bas :
* Le Nouvel Observateur, 24.09.2009, Propos recueillis par Marie Lemonnier, in « Homosexuels en banlieue. ‘‘C’est la double peine’’ ».
« (…) Les chiffres produits par SOS Homophobie en 2006 sont éloquents : il y a quatre fois plus d’agressions physiques homophobes en banlieue qu’ailleurs, 54% d’entre elles étant le fait de bandes de jeunes et 49% provenant de l’entourage immédiat. Comme le dit Majid, l’un de mes témoins, « c’est du trash, la vie des pédés dans les cités »
Ainsi, SOS homophobie participe à la construction de l’homophobie comme problème « des banlieues », d’une part par son silence concernant l’usage qui est fait de ses statistiques. D’autre part, elle participe à une logique d’homogénéisation de la catégorie « en produisant des chiffres sur l’ensemble des quartiers [qui] ont pour effet d’unifier, sous une seule bannière, une réalité hétérogène » (Tissot 2004, 57).
En échange de la visibilité offerte par la promotion du livre, SOS homophobie rédige un communiqué de presse saluant sa publication et se positionnant dans la même ligne politique que lui [3], à travers l’emprunt des mêmes formules lexicales se trouvant dans le livre de Franck Chaumont, et l’utilisation des mêmes catégories telles que celles de « l’Etat républicain ». Comme Franck Chaumont, le communiqué désigne comme source d’homophobie des « traditions et […] interprétations religieuses archaïques ». Concernant la question des statistiques, leur énoncé, « ainsi le pourcentage d’agressions physiques émanant des banlieues s’élevait à 46 % des témoignages contre 12 % pour le reste du territoire », indique effectivement que l’information qui a circulé par la suite dans les médias n’était pas correcte. Si avant la parution d’Homo-ghetto, SOS homophobie avait déjà été sollicitée sur « l’homophobie en banlieue » par les journalistes, le « partenariat » entre les deux parties a permis une ouverture médiatique sans précédent à l’association. Il s’agit d’une collaboration négociée lors de deux rencontres plutôt informelles. Pour Franck Chaumont, il s’agissait d’une part de trouver un soutien institutionnellement légitime à ses propos :
« Aussi je citais beaucoup SOS Homophobie parce que c’est la seule association qui à un moment donné avait mené un travail sur les banlieues. Aucune association LGBT ne va dans les quartiers. C’est pas spécialement voulu, c’est le résultat de cette société à deux vitesses. Mais SOS homophobie est la seule association à travailler dans les quartiers donc je parlais beaucoup d’eux » [4] (Entretien avec Franck Chaumont)
D’autre part, cette rencontre lui permet de diffuser un appel à témoin sur le site de l’association. Franck Chaumont peut dès lors puiser au sein des rapports de SOS homophobie, association reconnue [5] par les institutions publiques et par les médias, une véritable rhétorique des statistiques, et une ligne dénonciatrice qu’il empruntera pour son propre livre. Du côté de SOS homophobie, cette collaboration est une réelle fenêtre d’opportunité. Si l’association occupe la place de référente principale pour les questions liées à l’homophobie, elle reste cependant à la recherche d’opportunités pour améliorer sa visibilité au sein de l’espace public. Ce partenariat avec Franck Chaumont était de ce point de vue très intéressant, puisqu’il impliquait que l’auteur cite les chiffres de SOS homophobie le plus souvent possible lors de ses apparitions médiatiques. De fait, la couverture médiatique dont a bénéficié l’association a été relativement étendue. L’attachée de presse en charge de la promotion du livre de Franck Chaumont, avait effectivement intégré la référence à SOS homophobie comme un argument de promotion du livre. Ainsi, l’association a pu largement bénéficier des stratégies de promotion du livre mises en place, notamment lors du début du lancement de la promotion.
Notes de la partie 2
[1] SOS homophobie (2006), Chapitre « Banlieues », in Rapport Annuel, p. 73
[2] Au sens de DESROSIERES (1989), op. cit
[3] Communiqué de presse de SOS homophobie à la sortie du livre, in SOS homophobie (2006), p. 167.
[4] En réalité, SOS homophobie ne va pas dans « les quartiers ». Une enquête quantitative été lancée en 2004 par le « Groupe Banlieue » sous la forme d’un questionnaire sur Internet. Cette initiative a été relayée dans les médias.
[5] L’association entretien des liens entre autre avec le Ministère de l’Education Nationale pour l’agrément national lui permettant d’intervenir en milieu scolaire. Le Ministère de la Jeunesse et des Sports finance par ailleurs ces interventions dans une certaine mesure. Un véritable travail sociologique reste cependant à faire sur l’association et sur ses liens avec les institutions de l’Etat.
Partie 3
Le déni de la stigmatisation
SOS homophobie est une association qui entretient des liens spécifiques avec les autorités publiques, les administrations et les médias. Si elle se tient à la disposition de personnes en difficultés à travers la ligne d’écoute anonyme, c’est également à ces structures-là que sont destinées ses productions. Le fonctionnement de ces dernières aura donc toutes les chances de peser sur le registre de discours de l’association.
L’apparition du « Groupe Banlieue » ne peut ainsi pas être appréhendée en dehors du contexte socio-politique qui plaçait les banlieues françaises sur le devant de la scène politique et médiatique en 2004 et 2005 [2]. Elle est tributaire d’un certain « cadrage » (Benfort et Hunt, 2001, 163-194) des questions liées aux banlieues qui se met en place dans ce contexte précis. SOS homophobie est une association dont l’un des buts est de faire reconnaître l’homophobie comme un problème public légitime et existant. Il est important pour elle de maintenir une certaine visibilité dans l’agenda politique dominant. SOS homophobie étant une structure relativement importante dans le champ associatif LGBT, il s’agit pour elle d’être considérée comme une interlocutrice crédible auprès de certaines institutions. A cette fin, il est nécessaire de s’adapter aux registres discursifs, aux grilles de lectures, aux inquiétudes légitimes qui circulent au sein des sphères influentes et dominantes. Il s’agit dès lors de s’interroger pour comprendre ce processus de cadrage :
« De quoi parlent les interlocuteurs et de quoi ne parlent-ils pas ? (…) Comment font-ils apparaître des sujets et des objets, des actions et des événements, des faits et des représentations et quel lien se met en place entre ce qui se donne à voir et à entendre dans la conversation et la situation des locuteurs ? » (Cefaï, 2007, 558).
Car « certaines versions de la ‘‘réalité’’ ont un plus grand pouvoir que d’autres de définir et de décrire cette ‘‘réalité’’. (…) Ces traits de la structure contribuent à ‘‘ce que tout le monde sait’’, le caractère du ‘‘sens commun’’ ou du ‘‘tenu pour allant de soi’’ qui indexe la production du monde objectif dans l’expérience vécue » (Gusfield, 2006, 21).
En d’autres termes, il est impératif de coller aux « sujets prioritairement discutés dans l’espace public (…) ou, plus précisément, [à] la hiérarchie des sujets les plus côtés dans chacune des arènes qui déterminent le cours de l’action publique » (Blanchard, 2009, 24).
Cette stratégie permet de multiplier les apparitions dans les médias en s’adaptant aux rhétoriques les plus légitimes, et de faciliter en même temps l’accès de l’association aux administrations publiques, sources de financement et de stabilité institutionnelle. « Les banlieues », à ce moment-là, sont au cœur des sujets journalistiques, des reportages (Sedel, 2009), mais également des discours sécuritaires des forces de police ou des autorités publiques. Elles font l’objet de mise en place de réformes administratives. Par dessus tout, les questions « du sexisme » et de la « délinquance en banlieue » sont déjà des enjeux présents dans les débats publics (Sedel, 2009 ; Tissot 2007 ; Guénif-Souilamas 2004). Les enquêtes lancées, les thèmes abordés sont également subordonnés à l’agenda politique du moment. Ce dernier, définissant les objets prioritaires à traiter, définit également les projets qui seront les plus à mêmes à obtenir des financements et des aides.
C’est donc précisément à cette époque (en 2005), qu’est lancé un questionnaire informatique sur la question spécifique de « l’homophobie en banlieue ». Si le « Groupe Banlieue » n’a a priori pas obtenu de financement particulier pour cette enquête, cette dernière a été relayée à plusieurs reprises dans les médias. L’association contribue ainsi à élargir le répertoire discursif concernant « les banlieues » qui circule au sein des sphères médiatiques et politiques en y ajoutant la question de l’homophobie.
L’enquête statistique constitue un langage à travers lesquels des informations circulent entre champs sans pour autant subir en apparence une modification trop importante. Très fortement liée à l’Etat dans son histoire (Desrosières 2000, 121-137), la discipline statistique constitue (avec par exemple le vocabulaire judiciaire) un langage couramment employé afin de décrire certains aspects des sociétés humaines. Sous leur forme la plus simplifiée, graphique, les chiffres statistiques sont rendus lisibles par des procédés d’homogénéisation et par certains choix techniques (comme celui de mettre en avant certaines variables et pas d’autres). Le langage statistique vulgarisé se plie volontiers à une lecture rapide et simple.
Le « Groupe Banlieue », les chapitres liés « aux banlieues » ainsi que les enquêtes à ce sujet ont disparu en 2008. Interrogé à ce sujet, un responsable actuel de SOS homophobie prend grand soin de se distancer.
* « Alors justement, j’ai vu que vous aviez un groupe banlieue…
* Nan. On a plus. C’était y a très longtemps.
* C’était y a très longtemps, c’était y a combien de temps ?
*C’était y a au moins quatre ans.
*Et vous savez pourquoi il a disparu ?
* Pas du tout. Je suis arrivé dans l’association après. Et j’ai vu effectivement dans les archives un jour un groupe banlieue qu’on avait eu à un moment donné, je ne sais pas ce qu’il est devenu, je ne sais pas pourquoi il s’est arrêté. Non, je peux pas vous dire.
* Ok. Vous savez pas les gens qui étaient dedans par exemple ?
* Pas du tout.
* Donc vous savez pas du tout l’histoire de ce groupe alors ?
* Non.
* OK. » (Entretien avec Noé, SOS homophobie)
A première vue, l’association semble avoir subi un certain glissement de position depuis le dernier chapitre du « Groupe Banlieue ». La suppression du groupe banlieue depuis « très longtemps » ainsi que celle du chapitre qui y était lié au sein du rapport annuel de l’association en serait la preuve. Les membres active/fs interrogé-es, à l’image de Noé, sont conscient-es du fait que la banlieue engage un certain enjeu et qu’il est nécessaire d’être prudent-es sur le sujet.
* Et j’ai vu que y avait une enquête de SOS en 2005 ou 2006, il y avait un groupe banlieue, c’est ça ?
* « Oui. Il y avait un groupe banlieue, mais il a pas duré (…) les gens qui s’occupaient de ça, c’était un noyau de 4, 5 personnes qui ne sont plus dans l’association… donc c’est tombé… les questions de banlieue… y a eu des réflexions, des comptes-rendus, mais pas plus que ça… ça aurait mérité, ça mériterait effectivement un sujet en soi, mais là on est pris un peu dans une… là, avant de s’attaquer à ça… y a une réflexion à mener. C’est-à-dire que on ne peut pas se jeter à corps perdu dans l’analyse des questions de banlieue dès lors qu’on isole… de mon point de vue hein, dès lors que l’on isole un terrain de recherche, en quelque sorte, on l’isole c’est-à-dire qu’on éteint la lumière tout autour et on ne met que ça en lumière. Et ne mettre que ça en lumière, pour nous qui sommes très sensibles à ces sujets-là, on risquerait de stigmatiser tel ou tel contexte, tel ou tel lieu. » (Entretien avec Paul, SOS homophobie)
A l’instar de Noé, Paul semble conscient des limites de l’exercice. Il est délicat d’« isoler » la question de l’homophobie « en banlieue », car il existe des risques de stigmatisation. Se dire conscient-es de ses limites semble fonctionner au sein de SOS homophobie comme une façon de légitimer les actions entreprises par l’association. Au niveau statistique par exemple, reconnaître que les chiffres produits par l’association comportent certaines faiblesses et expliquer qu’il ne s’agit pas de pratiques professionnelles permet de se décharger en partie d’une certaine responsabilité liée aux effets potentiels de ces chiffres.
« On a une statistique au niveau global, on a un paysage, un paysage en aquarelle, on a pas la précision d’une photographie. Et plus on rentre finement dans les détails, dans les calculs, moins la portée statistique des données est pertinente, on le sait. On sait les limites de tout ça… mais encore une fois, y a rien de mieux… moi j’ai fait de la science économique donc je sais comment les statistiques… ça m’amuse toujours ça parce que… ça n’est pas les statistiques qui sont dangereuses, c’est l’usage qu’on fait des statistiques, ce qu’on veut faire dire aux statistiques, et c’est là où ça peut devenir n’importe quoi… et nous on le sait. C’est-à-dire qu’on ne prétend pas faire dire à nos statistiques ce qu’elles ne disent pas. Mais on prétend quand même leur faire dire ce qu’elles disent. » (Entretien avec Paul, SOS homophobie)
Parallèlement à cet aveu de faiblesse, l’association signe un accord de collaboration avec Franck Chaumont, et ne dément pas les références erronées à des chiffres eux-mêmes déjà délicats de par leur processus de production. De même, la dissolution du « Groupe Banlieue » et du chapitre « Banlieues » du rapport annuel ainsi que la contribution d’Eric Fassin (2010) dans le rapport de 2010 [3] semblent fonctionner comme la caution d’une posture non stigmatisante envers les habitant-es de la périphérie parisienne. Pourtant, et si à partir de 2007, une partie du rapport n’est plus accordée aux « banlieues », le champ lexical utilisé pour désigner des agresseurs supposés « de banlieue » reste le même jusqu’à aujourd’hui : on parle encore et toujours de « jeunes » qu’ils soient « de banlieue », « de cité », ou « en bande ». Ainsi, s’il a subi quelques évolutions, le discours de SOS homophobie reste cependant le même qu’en 2005 et 2006 sur le fond.
« Etre gay ou lesbienne en banlieue, est-ce plus difficile qu’ailleurs ? Ce n’est pas pour stigmatiser la banlieue que nous nous posons cette question mais bien parce que nous avons remarqué que l’homophobie dans les banlieues avait des caractéristiques propres. (…) Les données analysées dans ce chapitre ne représentent que 3% des témoignages reçus par SOS homophobie en 2005, mais leur teneur justifie que nous consacrions un chapitre de ce rapport annuel à ce sujet » (Introduction du chapitre « Banlieue » du rapport annuel 2006 de SOS homophobie)
Alors qu’elle verbalise et met en avant la volonté de « ne pas stigmatiser », l’association mobilise un certain registre lexical qui fonctionne en terme d’âge, de religion ou de race. A travers ses rapports et ses communiqués de presse, elle contribue à reproduire les représentations circulant sur les « habitant-es des banlieues ». Ce registre lexical s’illustre par exemple par le communiqué de presse commentant l’agression de deux lesbiennes à Epinay-sous-Sénart dans la cité des Gerbaux dans l’Essonne, le jeudi 2 juillet :
« Nicolas Sarkozy avait pourtant, parmi ses nombreuses promesses, affirmé qu’il remettrait les valeurs de la République au sein des cités. Pourtant, force est de constater une fois encore que ce sont des jeunes, imbibés de discours religieux sexistes, machistes et homophobes, qui font la loi dans certains quartiers. Où sont les valeurs laïques de la République ? Les discours et les pratiques religieuses intolérantes se développent à une vitesse inquiétante dans certaines banlieues. De multiples lieux de cultes divers et variés se développent dans l’indifférence des autorités, épandant un terreau d’intolérance et de haine notamment vis à vis des femmes et des homosexuel-le-s. »
Afin de réussir à faire tenir harmonieusement des positions qui semblent pour le moins opposées, une des stratégies mises en avant dans les rapports de 2005 et 2006 (dont le président actuel cherche à se distancer), est d’expliquer que si l’homophobie n’est peut-être pas plus grande « en banlieue » qu’ailleurs, elle se manifeste néanmoins avec plus de violence.
« Il n’y a peut- être pas plus d’homophobie en banlieue qu’ailleurs, mais en tout cas elle s’y exprime avec plus de force et de virulence » (rapport annuel SOS homophobie 2006, p. 74)
* Le fait que vous interveniez dans des milieux plutôt défavorisés vous pensez que c’est dû à quoi ?
* « D’une part, peut-être que les manifestations d’homophobie sont plus éclatantes et que donc de la part de l’équipe pédagogique il y a une conscience plus grande de la nécessité d’intervenir. Ca veut pas dire que y a plus besoin dans ces établissements-là que dans certains établissements parisiens où l’homophobie peut être beaucoup plus larvée, beaucoup moins visible et éclatante et spectaculaire d’une part. (…) Je pense vraiment que c’est parce que les manifestations de l’homophobie ne sont pas les mêmes. Mais comme on a très souvent cette image qui est assez fausse qu’il y a plus d’homophobie en banlieue que dans les villes… c’est faux. Les témoignages le prouvent et ça rejoint d’ailleurs les propos d’Eric Fassin, c’est parce que l’homophobie dans les cités est beaucoup plus éclatante, beaucoup plus marquée de façon visible qu’elle est considérée comme plus présente, alors qu’en réalité on a dans nos témoignages à nous à SOS homophobie autant de témoignages quand ça concerne Versailles ou St Denis, le centre de Paris ou le 20e arrondissement, enfin je veux dire… » (Entretien avec un responsable de SOS homophobie)
Ce mécanisme est particulièrement éclairant lorsqu’il s’agit des interventions en milieu scolaire (IMS). Une des stratégies de distanciation par rapport à la « stigmatisation » se situe ainsi dans le fait de parler de la forme de l’homophobie. Tout en ne posant pas explicitement une hiérarchie entre les typologies d’homophobie décrites, ce qui reviendrait à « stigmatiser », l’association les différentie par leur caractère plus ou moins « flagrant », « éclatant », ou « violent et virulent ». Le nombre d’interventions en milieu scolaire, plus élevé dans des milieux plus défavorisés est ainsi souvent repris comme symptôme d’une forme d’homophobie plus flagrante pour ne pas dire plus grande.
« Alors en fait on a eu de la chance, on a jamais eu à démarcher. Pour l’instant. Y a eu suffisamment de bouche à oreille et on a été suffisamment visibles pour que ça soit systématiquement les établissements [scolaires] qui nous contactent de leur propre chef. Ca peut être des profs, des documentalistes, des infirmiers, des infirmières, des CPE, des proviseurs, » (Entretien avec Noé, SOS homophobie)
Pour Noé, les demandes plus nombreuses en provenance de lycées et de collègues situés dans des quartiers moins favorisés seraient le signe d’une homophobie plus flagrante. Le recours aux interventions de SOS homophobie est ainsi considéré comme un marqueur du degré d’homophobie présent, ou du moins du type d’homophobie. Dans cette optique, plus certaines catégories d’établissements font recours à l’association, plus leurs élèves seraient sujet-tes à des formes d’homophobie « virulentes ». Les établissements les plus demandeurs étant également les plus populaires, il en résulte selon cette logique que les formes d’homophobie virulentes interviennent dans les milieux les plus populaires.
Or on sait que les profils sociologiques des enseignant-es ainsi que du personnel pédagogique des établissements scolaire est directement déterminé par le type d’établissement par lequel elles/illes sont employé-es. Plus les écoles sont situées dans des zones socialement défavorisées, plus les enseignant-es qui y travaillent sont jeunes et précaires. « Par rapport aux lycées très ‘‘bourgeois’’, les établissements très populaires recrutent donc chaque année deux fois plus d’enseignants et, parmi ceux-ci, deux fois plus de très jeunes professeurs. La rotation du personnel s’accélère, par conséquent, régulièrement lorsque l’on descend la hiérarchie sociale des établissements, en même temps que s’accroît de façon considérable la part prise par les plus jeunes enseignants dans les arrivées » (Léger, 1981, 558). Si plus jeune et plus précaire ne signifie pas automatiquement plus sensibilisé-es aux questions liées à l’homophobie, l’âge, l’orientation politique des enseignant-es, leur profil sociologique, en somme, ou leurs représentations concernant « l’homophobie en banlieue » influe directement sur l’intérêt pouvant être porté aux interventions en milieu scolaire. Il devient dès lors incontournable de prendre en considération le profil sociologique du personnel pédagogique afin de comprendre la distribution dans l’espace urbain des interventions en milieu scolaire de l’association. Une telle démarche permet de rompre avec l’idée de sens commun selon laquelle l’association intervient aux endroits où l’homophobie serait effectivement un problème plus important qu’ailleurs.
Conclusion : une crédibilité institutionnelle et ses effets
Les membres de SOS homophobie sont dans une certaine mesure conscient-es des limites des statistiques produites par leur association. Dans certains cas, comme chez Paul, cet aveu de faiblesse est associé à une certaine réflexivité quant à la composition sociologique des membres de l’association et des risques d’ethnocentrisme dans la volonté d’étudier « l’homophobie en banlieue ». Ces doutes s’arrêtent cependant à la table d’entretien, et ne transparaîtront jamais dans l’utilisation médiatique et politique des chiffres et des rapports annuels de l’association. Ces remises en question contrastent sensiblement avec la manière dont SOS homophobie est mobilisée dans les médias.
Si le chiffre statistique est bricolé et branlant, sa quantification, son indexation, sa mise en page puis sa diffusion le dotent d’un vernis de scientificité, de sérieux, et contribuent à renforcer la crédibilité de l’association auprès des interlocutrices/eurs légitimes qui peuvent à leur tour contribuer à sa stabilité, voir à son agrandissement. Par l’intermédiaire d’un acteur dont la promotion du livre dépend en partie de l’existence des statistiques, les glissements heuristiques qui accompagnent la vie du chiffre politique contribuent à renforcer l’existence de la question de « l’homophobie en banlieue » comme pertinente, actuelle et urgente.
* « Est-ce que vous avez des sollicitations de la part de médias ?
* Oui. Parce que c’est le seul document qui existe aujourd’hui en France qui produit des statistiques sur les formes d’homophobie en France, et du coup c’est le seul document sur lequel tout le monde s’appuie pour les chiffres. Et on est la référence, et c’est triste à dire d’ailleurs, parce qu’on est pas une référence institutionnelle du tout. Enfin, c’est tant mieux pour nous, je veux dire, mais on aimerait que les pouvoirs publics ou la police, ou j’en sais rien, les personnes qui sont dans les institutions administratives puissent produire des chiffres réels, parce que nous on se base sur les témoignages qu’on a, mais toutes les victimes ne témoignent pas, donc c’est la face émergée de l’iceberg, et… voilà. Mais c’est le seul document qui existe du coup c’est la base… c’est celui qui est utilisé pour… je sais pas, là y a M. O qui vient de nous demander d’utiliser nos chiffres pour les mettre, les ministères utilisent nos chiffres, les autres associations se basent sur nos chiffres, et les médias se basent sur nos chiffres. Donc on publie le 17 mai, journée mondiale de lutte contre l’homophobie, et en général on le publie une ou deux semaines avant pour la presse, le temps de potasser un peu. » (Entretien avec Noé)
La torsion du chiffre est rendue d’autant plus aisée qu’elle n’émane pas directement des responsables ou des membres de l’association, mais d’un tiers (l’auteur) qui s’en fait le relais. La crédibilité institutionnelle et publique de l’association laisse ensuite la place à celle des journaux (ou des médias en général) qui relaient l’information. A partir de ce moment, le chiffre n’est plus lu dans le rapport annuel de l’association, mais entre les pages d’un journal connu et reconnu (tels que Le Nouvel Observateur, Marianne, etc…). Désormais, ce n’est plus tant SOS homophobie qui déclare que « 46% des agressions physiques homophobes proviennent de banlieue », mais le média qui relaie cette information. Ainsi, SOS homophobie, profitant de cette aubaine publicitaire, ne relève pas le glissement sémantique du sens de ses chiffres qu’elle contribue par son silence à rendre « vrais » et à cristalliser.
La naissance des statistiques comme méthode d’observation et de mesure des populations est intimement liée à l’histoire des Etats. Desrosières distingue dans la construction sociale des statistiques, les étapes de la qualification et de la quantification. « Pour compter ou mesurer des objets, il faut les identifier et les qualifier au préalable, ou définir des étalons de mesure à partir de propriétés qualitatives » (Desrosières, 1995, 14). Cette première étape, « issue plutôt du droit, de la vie administrative, de la médecine, construit des classes d’équivalence, des catégories, et affecte des cas singuliers à celles-ci à travers des jugements, des décisions, des diagnostics ou des procédures de ‘‘codage social’’ (Thévenot 1983) ».
Une fois le contour de ces éléments dessinés, l’on peut dès lors leur associer des chiffres. Ceci illustre relativement bien le phénomène de qualification puis de quantification qui a donné sens aux notions de ‘‘banlieues’’ ou de ‘‘quartiers sensibles’’. Sylvie Tissot (2004 ; 2007) a montré comment les pratiques de certains statisticiens travaillant en collaboration avec les autorités publiques ont contribué à l’apparition de la catégorie des quartiers dits sensibles. Cette opération a ainsi ouvert la voie à la production, sur la même catégorie, de toutes sortes de statistiques, qu’elles soient menées par des institutions liées à l’Etat ou par des associations qui en sont plus éloignées mais qui restent tributaires des pouvoirs publics, telles que SOS homophobie.
Pour comprendre comment s’installent certaines représentations de la sexualité, il s’agissait ici d’étudier le processus par lequel une grille de lecture particulière de l’homophobie désignant les quartiers dits sensibles et leurs habitant-es comme étant plus homophobes que celles et ceux des centres villes français, en vient à s’installer au sein des discours médiatiques et politiques. Pour cela, cet article s’intéresse à la production de chiffres statistiques largement relayés dans le champs médiatique qui participent à la construction de cette grille de lecture de l’homophobie. J’ai montré qu’au-delà des modes de production des statistiques (qui peuvent être délicats), c’est avant tout l’usage politique qui en est fait qui est primordial dans la construction de certaines questions en véritables enjeux publics. Dans ce cas, l’importante « erreur » de lecture de Franck Chaumont, le manque total de réaction de la part de SOS homophobie, le relais massif de ces informations erronées par les médias et finalement le fait que leur véracité et leur pertinence ne soit à aucun moment interrogée, montrent à quel point cette grille de lecture de l’homophobie en termes culturalistes et racisés façonne d’ores et déjà les visions dominantes et légitimes des rapports à la sexualité en France.
BIBLIOGRAPHIE
* AVDIJA Elena, « La construction de l’homophobie comme problème des banlieues françaises », Mémoire de recherche Master 2, Pratiques de l’interdisciplanirité, ENS/EHSS, sous la direction de Sylvie Tissot, 2011.
* BENFORT Robert, HUNT, « Cadrages en conflit. Mouvements sociaux et problèmes sociaux », in Cefaï D., Trom D. (dir.), Les formes de l’action collective, Paris, Editions de l’EHESS, 2001, pp. 163-194.
* BLANCHARD Philippe, « Agenda », in Fillieule O., Mathieu L., Péchu C., Dictionnaire des mouvements sociaux, Paris, Presse de Sciences Po, 2009, p. 24.
* CEFAI Daniel, Pourquoi se mobilise-t-on ? Les théories de l’action collective, Paris, La Découverte, 2007.
* CHAUMONT Franck, Homo-ghetto, Gays et lesbiennes, les clandestins de la République, Paris, Le Cherche Midi, 2009.
* DESROSIERES Alain, « Comment faire des choses qui tiennent : histoire sociale et statistiques », in Histoire et Mesure 4 (3-4), 1989, pp. 225-242.
* DESROSIERES Alain, « Classer et mesurer : les deux faces de l’argument statistique », in Réseaux 13 (71), 1995, pp. 11-29.
* DESROSIERES Alain, « L’histoire de la statistique comme genre : style d’écriture et usages sociaux », in Genèses 39, 2000, pp. 121-137.
* FASSIN Eric, « Le point de vue d’Eric Fassin », in SOS homophobie, Rapport annuel 2010, 2010, p. 13
* GUENIF-SOUILAMAS Nacira, MACE Eric, Les féministes et le garçon arabe, Paris, Editions de l’aube, 2004.
* GUSFIELD Joseph, La culture des problèmes publics. L’alcool au volant : la production d’un ordre symbolique, Editions Economica, 2006.
* KOSOFSKY-SEDGWICK Eve, L’épistémologie du Placard, Paris, Editions Amsterdam, 2008 (1990).
* LEGER Alain, « Les déterminants sociaux des carrières enseignantes », in Revue française de sociologie, 22 (4), 1981, pp. 549-574.
* NAÏT-BALK Brahim, Un homo dans la Cité, Paris, Calman-Levy, 2009.
* PROUST Marcel (1921) cité par ERIBON Didier, Réflexions sur la questions gay, Paris, Fayard, 1999, p. 13.
* RIVERA Annamaria, « Culture » in Galissot R., Kilani M., Rivera A., L’imbroglio ethnique, Lausanne, Editions Payot, 2000, pp. 63-82.
* SEDEL Julie, Les médias et la banlieue, Paris, Editions Le Bord de l’eau. SOS homophobie (2006), Chapitre « Banlieues », in Rapport Annuel, 2009, pp. 73-80
* TISSOT Sylvie, « Identifier ou décrire les ‘‘quartiers sensibles’’ ? Le recours aux indicateurs statistiques dans la politique de la ville » in Genèses 54, 2004, pp. 90-111.
* TISSOT Sylvie, L’Etat et les quartiers. Genèse d’une catégorie de l’action publique, Paris, Seuil, 2007.
* VOLPP Leti, « Quand on rend la culture responsable de la mauvaise conduite », in Nouvelles Questions Féministes, 25 (3), 2006, pp. 14-31.
Notes
[1] Voir les rapports 2005 et 2006 de SOS homophobie. Les rapports sont disponibles sur le site Internet de l’association.
[2] Il faudrait faire tout une enquête sociologique sur le « Groupe Banlieue » de SOS homophobie pour
mieux comprendre le rapport de l’association aux « banlieues ». Travail que je n’ai pas pu effectuer ici, faute de temps et d’espace.
[3] Eric Fassin intervient dans le rapport 2010 de SOS homophobie sous la forme d’une page d’opinion placée au début du rapport : « Le point de vue d’Eric Fassin ». La fin de son intervention met le doigt sur certains mécanismes de stigmatisation de classe. Cette intervention, hautement légitime pour les dirigeant-es de l’association, contribue à leur donner le sentiment d’aller à l’encontre de cette stigmatisation que dénonce l’intellectuel dans sa contribution : « (…) Mais il faut mettre en garde contre les effets pervers de cette norme nouvelle : l’homophobie n’est-elle pas surtout illégitime dans des groupes sociaux illégitimes ? C’est un peu comme le racisme : l’homophobie, c’est les autres ! La lutte contre l’homophobie apparaîtrait alors comme l’instrument d’une stigmatisation des classes populaires et des jeunes des banlieues. Le risque, c’est qu’en retour l’homophobie soit brandie comme une arme de résistance au racisme (de classe). Oublier l’homophobie “distinguée” pour ne dénoncer que l’homophobie “ vulgaire ”, c’est donc entrer dans un cercle vicieux, qui alimente l’homophobie au moment de la combattre »